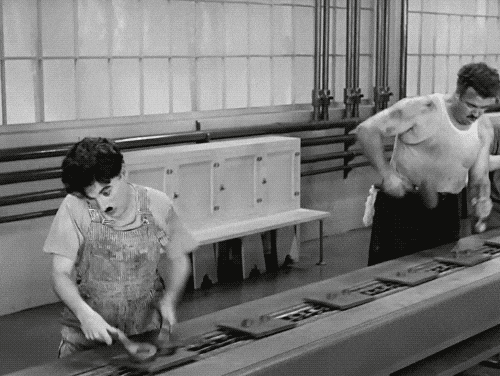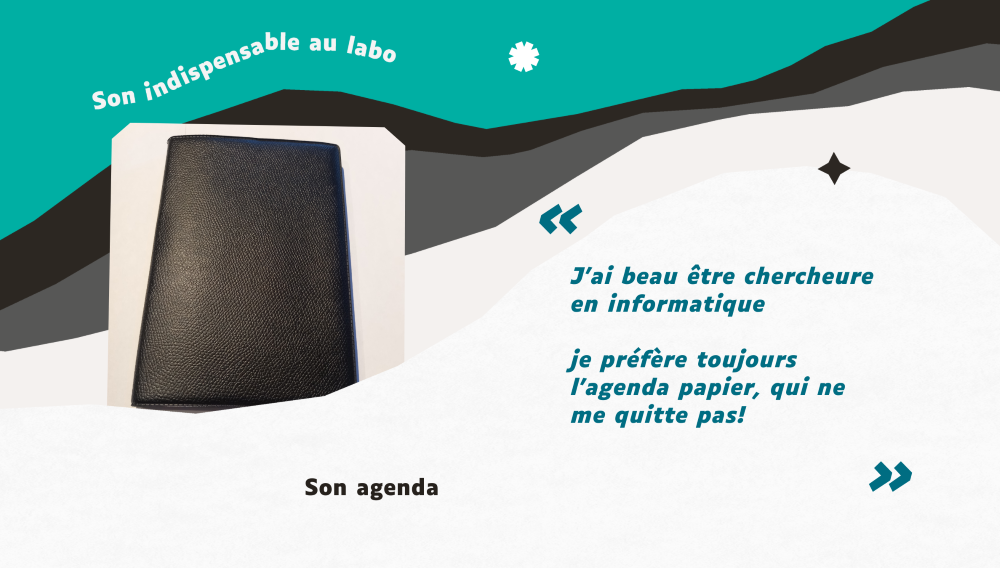Navigant entre Montluçon et Clermont Ferrand, l’enseignante-chercheure Sylvie Norre déploie une énergie sans mesure pour faire connaître aux jeunes une filière méconnue, encore trop masculine : le management de la logistique et des transports.
Navigant entre Montluçon et Clermont Ferrand, l’enseignante-chercheure Sylvie Norre déploie une énergie sans mesure pour faire connaître aux jeunes une filière méconnue, encore trop masculine : le management de la logistique et des transports.
Cet après-midi-là, quand je retrouve Sylvie Norre au Limos[1] sur le site des Cézeaux, l’ambiance est étonnamment calme. Nous prenons place dans une grande salle vide aux volets baissés. Dehors le soleil printanier explose, la pénombre a quelque chose d’apaisant. Rien ne trahit alors le formidable dynamisme qui caractérise la femme qui me fait face. « Elle est extraordinaire au sens de « hors norme », dit pourtant d’elle sa collègue Anne-Céline Palier[2]. Elle a une énergie dans le travail et dans la vie qui déplace des montagnes. »
Depuis plus de trente ans, Sylvie Norre navigue entre l’Allier et le Puy de Dôme, entre le site montluçonnais de l’IUT Clermont-Auvergne et celui des Cézeaux à Clermont-Ferrand. Elle est enseignante-chercheure, et comme tout·e enseignant·e-chercheur·e, elle cumule naturellement plusieurs fonctions (et mille autres projets). Il y a d’abord l’enseignement au département Management de la logistique et des transports[3] (MLT) à Montluçon. Elle et ses collègues y forment en trois ans (niveau BUT[4]) des étudiant·e·s, futurs technicien·ne·s, à la gestion du transport – routier, maritime, ferroviaire, aérien, fluvial, marchandises et voyageurs – et au management de la logistique. « On travaille beaucoup avec des intervenant·e·s professionnel·le·s » précise-t-elle. Intervenant·e·s qu’il s’agit de trouver, en nouant des collaborations avec des entreprises : là réside le deuxième aspect de son métier, plus administratif.
Et puis il y a la recherche bien sûr, au Limos (Laboratoire d'informatique de modélisation et d'optimisation des systèmes)[5], où elle se rend tous les jeudis – jour de réunion – pour ne pas se couper de la vie du laboratoire. Les trajets en voiture – 1h15 entre Montluçon et Clermont-Ferrand depuis 1993 – ne lui pèsent pas. Au contraire, le covoiturage est idéal pour échanger avec les collègues : « On vient à trois ou quatre. C’est l'occasion de régler plein de problèmes ! ». Travailler seule, Sylvie Norre n’en voit pas l’intérêt. Son truc à elle, c’est « le collaboratif et l’humain ».
Modélisation, simulation, optimisation
Le pragmatique aussi. Ainsi la recherche, Sylvie Norre la préfère appliquée : une recherche opérationnelle, appliquée à des problématiques industrielles ou hospitalières. Un exemple ? Il y a quelques années, le CHU a décidé de mettre en place une cuisine centrale (au lieu de plusieurs réparties dans les différents bâtiments). « Cette réorganisation était l’occasion de repenser l'ensemble des transports : repas, linge, médicaments... Combien de chauffeurs faut-il ? Combien de camions ? etc. » Le maitre-mot ? L’optimisation. « On fait de la modélisation, puis après de la simulation, et très souvent on hybride cela avec un module d'optimisation. » Devant mes sourcils froncés, la chercheure poursuit : « On fait communiquer la simulation et l'optimisation. L'optimisation propose des solutions, la simulation les évalue. » L’objectif étant in fine de développer des outils d’aide à la décision.
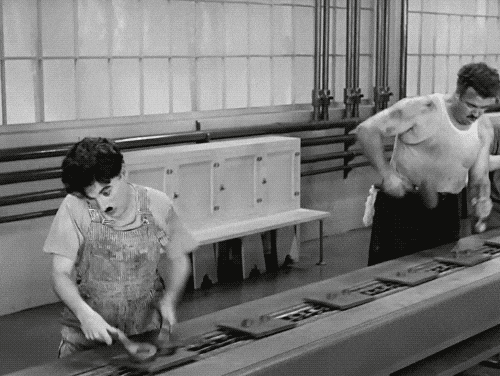
Autre exemple : l’équilibrage de lignes d’assemblage pour des entreprises comme le groupe PSA. « Imaginez Charlie Chaplin avec la voiture qui passe devant différents postes », illustre Sylvie Norre, soucieuse de vulgariser ses propos. À chaque poste, différentes opérations doivent être effectuées. Problème : comment répartir ces opérations de telle sorte que la somme de leur durée soit inférieure au temps de présence du véhicule au poste (on appelle cela le temps de cycle), sachant qu’il faut respecter des « contraintes de précédences » – à savoir, exemple trivial : mettre le pare-brise avant les essuie-glaces ?
Instit’ et maths
Voilà qui ressemble furieusement à un problème de maths. Ça tombe bien, Sylvie Norre aime beaucoup les maths, depuis toujours. C’est d’ailleurs ce qui l’a menée là : l’amour des chiffres. Celui de l’enseignement aussi. Enfant, elle voulait être institutrice. « Je me revois avec le tableau à la maison… Le hasard a fait que je suis devenue une instit’ pour des grands ! » Le hasard ? Pas sûr. Issue d’une famille d’agriculteurs, elle se rappelle des étés entiers passés à aider ses parents éleveurs. « Mes vacances, c'était la participation à la ferme. Je le faisais avec grand plaisir, mais je ne me voyais pas reprendre l’exploitation. C’était dur physiquement. » Après le baccalauréat, la jeune femme préfère s’engager dans un deug de mathématiques[6], avec l’idée, toujours, de devenir institutrice. Un stage en deuxième année dans une école primaire l’en dissuade.
La jeune femme poursuit néanmoins – licence, maitrise[5] – sans trop savoir où cela la mènera. Jusqu’à ce jour décisif : « Je me rappelle exactement la situation. J’errais sur le parking et j'ai rencontré une enseignante, qui sera ma directrice de thèse, qui m'a dit « Mais pourquoi tu ne ferais pas le DEA[5] d’informatique ? » J'aimais bien, en maths on avait fait de l'info. Je me suis dit pourquoi pas. » Après le DEA, elle obtient une bourse du ministère pour poursuivre en doctorat. « Après ça s’est enchaîné, j’ai eu de la chance. » Elle soutient sa thèse en février 1993, est recrutée en tant que maître de conférences quelques mois plus tard, et intègre le tout frais département MLT du site de Montluçon.
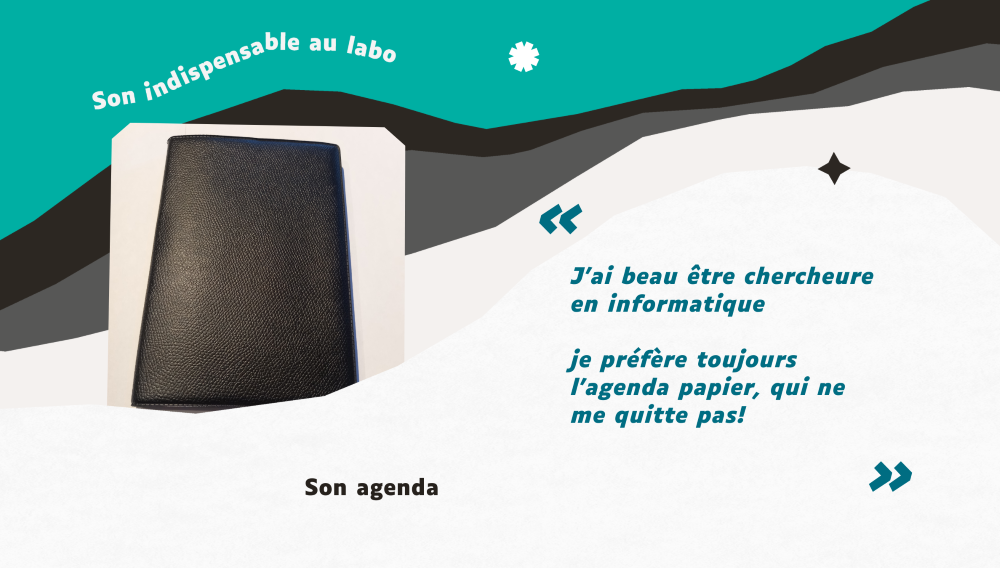
Accompagner les jeunes
Depuis, elle ne compte pas ses heures, notamment pour faire connaître la filière MLT. C’est que le BUT « management de la logistique et du transport » est une formation méconnue, qui peine à recruter des étudiants, et encore plus des étudiantes. Alors elle multiplie les projets avec ses collègues : « On fait des communications, des actions avec les collèges, les lycées, on a mis en place un campus des métiers et des qualifications… » énumère l’enseignante-chercheure. La liste n’est pas exhaustive : il y a aussi le Village de l’industrie[7], le Village des sciences[8] – « Je coordonne un peu ça… » L’énergie, toujours. « Des fois, je dois fatiguer mes collègues », plaisante-t-elle.
Sans oublier les cordées de la réussite : pour faire comprendre à des collégien·ne·s et lycéen·ne·s ce qu’est la logistique, leur « donner de l’ambition », Sylvie Norre et ses collègues ont mis en place en 2009 une cordée de la réussite « transport et logistique »[9]. « On fait concevoir aux jeunes une chaîne logistique d'un produit : où on s'approvisionne, où est-ce qu'on produit, où est ce qu’on distribue… » Les étudiant·e·s de l’IUT sont mis·e·s à contribution, « c’est ce qui marche le mieux, le contact étudiant-élèves » : ils se rendent dans les établissements pour encadrer les jeunes, lesquels viennent ensuite à l’IUT pour présenter leur chaîne logistique… Et ça marche : même s’ils ne sont pas nombreux, « il y en a qu'on avait en cordée qui sont arrivés ensuite chez nous ».
L’enseignante les encadre avec bienveillance. « Je crois que c’est accompagner les jeunes, le sens de mon métier. » Sa collègue Anne-Céline Palier, qui la connaît depuis vingt ans, confirme : « Sylvie est très présente pour les étudiants. C’est elle qui sait quand certains sont vraiment dans des situations bloquées, elle sait souvent trouver la clé. Elle est à l’écoute et sait faire avancer les gens par ses retours ».
Pour attirer les filles vers les sciences, participer à lutter contre l’auto-censure, Sylvie Norre participe en 2023 à la Journée internationale des femmes et des filles de science[10]. Elle y présente son métier à des élèves de seconde en mode « Speed searching » : « A partir d’un objet – j’avais pris un camion pour symboliser l’optimisation dans le domaine des transports – j’avais dix minutes pour présenter le métier de chercheur en informatique à des groupes de lycéennes », raconte-t-elle. La désaffection des filles pour les sciences, notamment pour les mathématiques, continue de l’étonner. Elle, ne se souvient pas avoir ressenti un quelconque complexe à embrasser une voie scientifique. « Je n’étais quand même pas dans le milieu le plus favorable pour aller faire des études : j'habitais dans une commune de l'Allier où peu de mes camarades faisaient des études à l’époque. Pourtant à aucun moment, je ne me suis dit que faire des études scientifiques n’était pas pour moi. » Peut-être parce qu’elle avait, déjà, de l’énergie à revendre.
[1] Laboratoire d'informatique de modélisation et d'optimisation des systèmes.
[2] Département management de la logistique et des transports (MLT) de l'IUT Clermont-Auvergne, site de Montluçon.
[4] Les BUT (Bachelors universitaires de Technologie) sont des diplômes en 3 ans qui se préparent dans un IUT (institut universitaire de technologie)
[5] Axe ODPS (outils décisionnels pour la production et les services)
[6] Le Deug (Diplôme d’études universitaires générales) sera supprimé en 2006 par la réforme LMD (Licence-Master-Doctorat). Avec la réforme, trois grades – Licence-Master-Doctorat – remplacent les Deug-licence-maitrise-DEA/DESS.
[10] Journée organisée par Centre d’Excellence de Science Partagée en Auvergne (Cespau) de l’UCA en partenariat avec le Rectorat de l’Académie de Clermont-Ferrand.
|