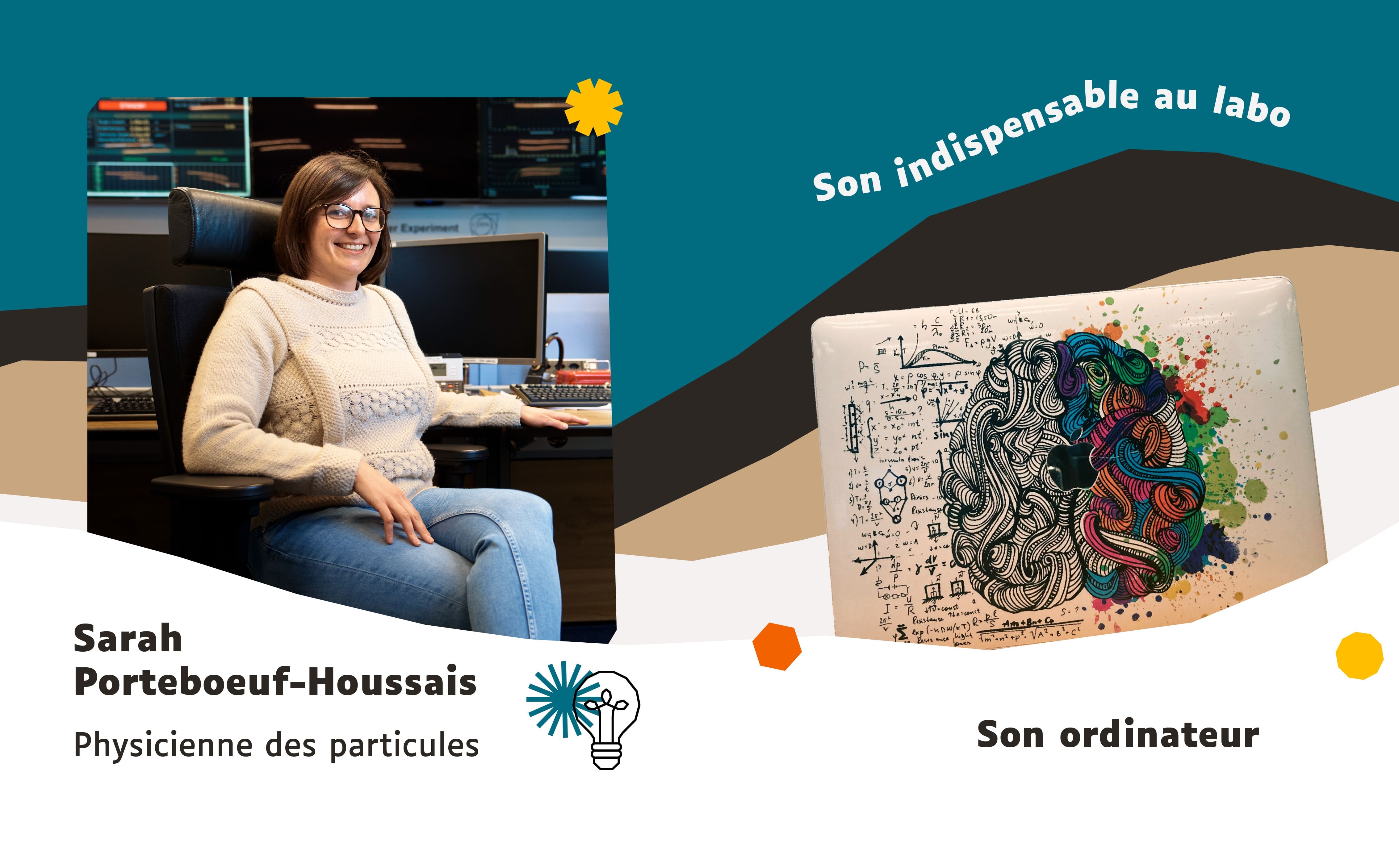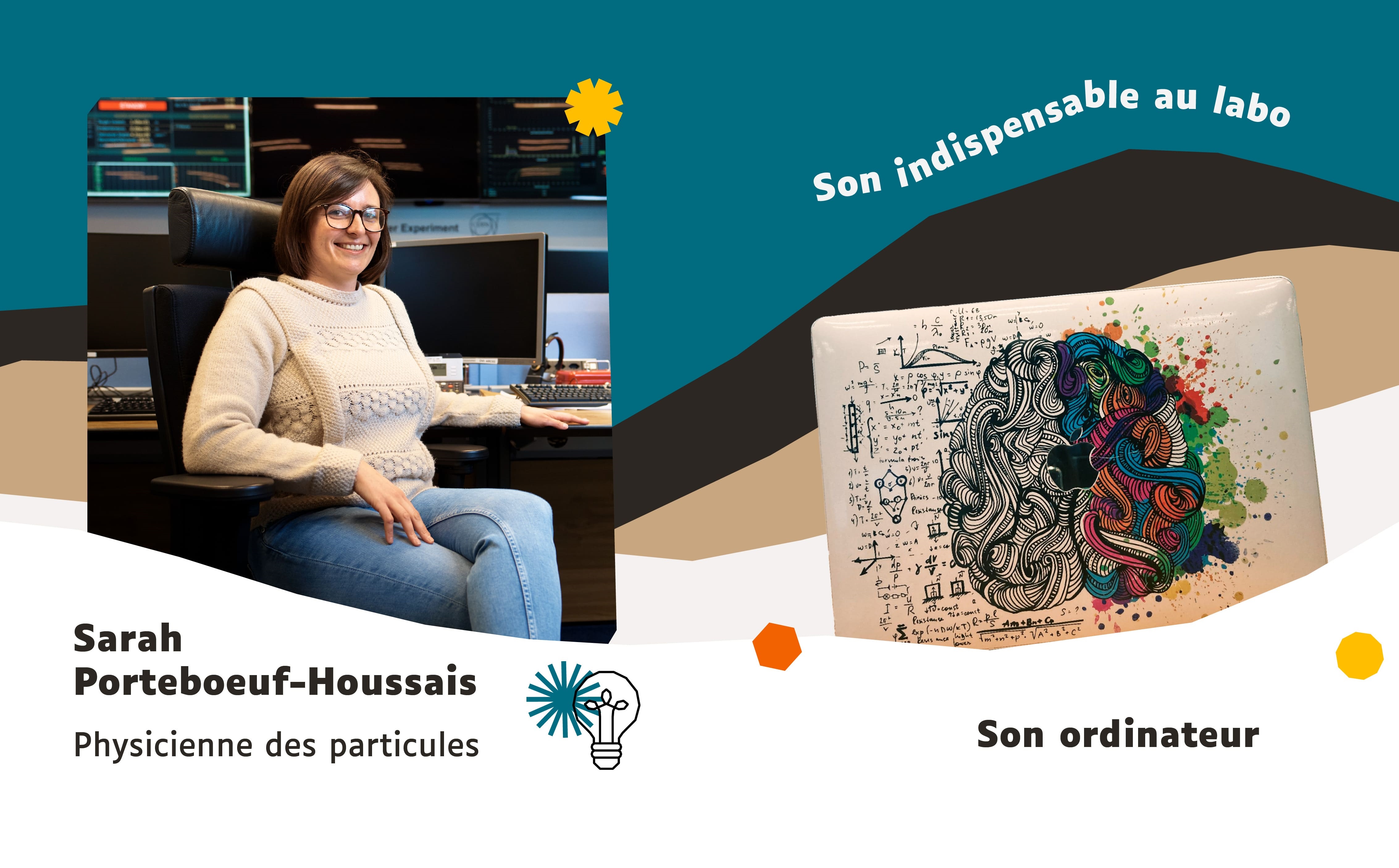Maître de conférences en physique à l’Université Clermont Auvergne, médaille de bronze du CNRS en 2022, Sarah Porteboeuf-Houssais poursuit sa quête obstinée : comprendre la matière, au niveau de ses constituants les plus élémentaires.
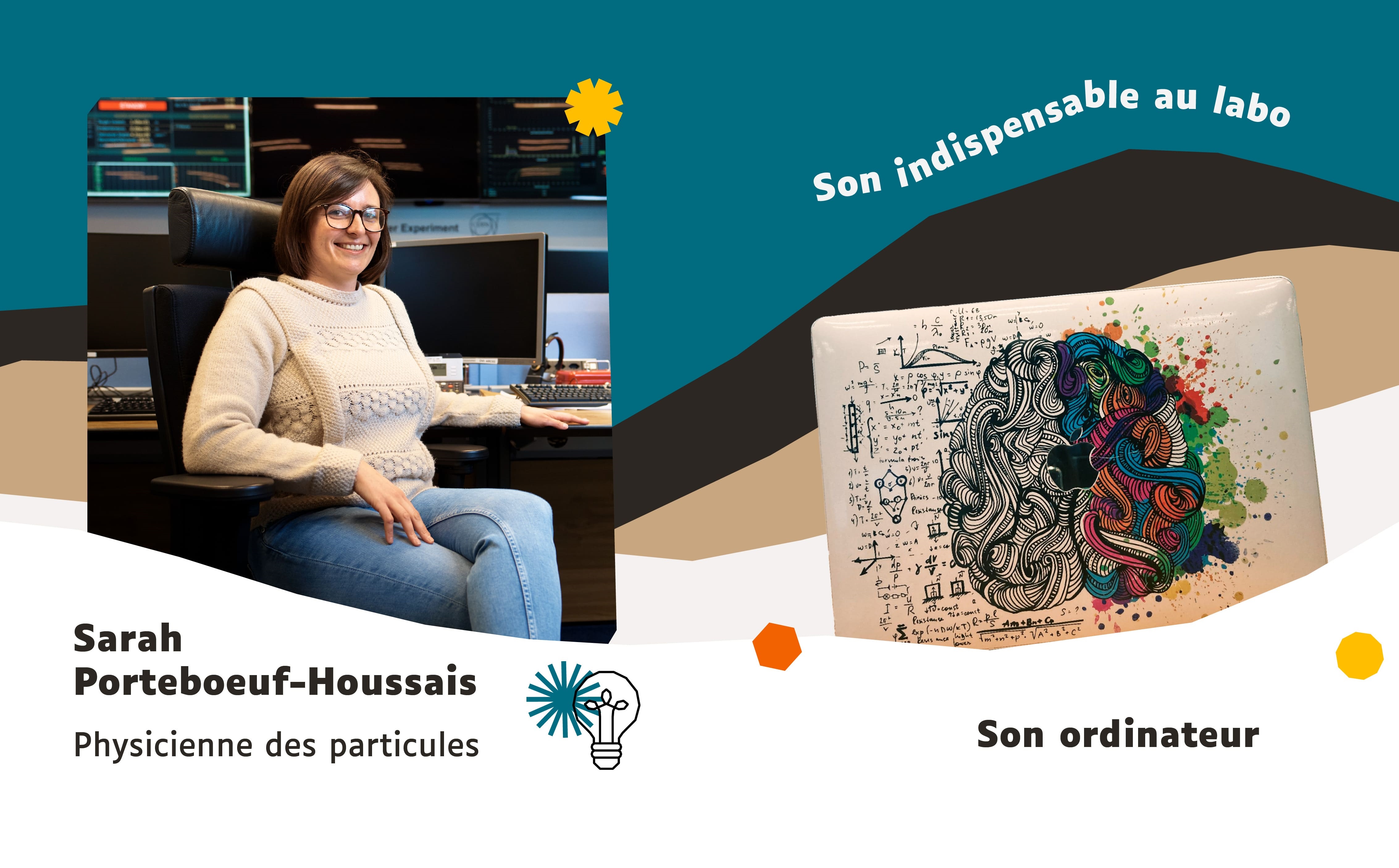
Maître de conférences en physique à l’Université Clermont Auvergne, médaille de bronze du CNRS en 2022, Sarah Porteboeuf poursuit sa quête obstinée : comprendre la matière, au niveau de ses constituants les plus élémentaires.
Déterminée. C’est le mot qui vient très vite à l’esprit quand on « rencontre » Sarah Porteboeuf-Houssais. En ce 5 mai 2023, la rencontre n’est que virtuelle. Et presque inespérée, car l’enseignante-chercheuse[1] est très occupée, doux euphémisme. Détachée depuis trois ans au CERN, l’organisation européenne pour la recherche nucléaire, elle est responsable du fonctionnement expérimental de l’expérience « ALICE[2]», qui regroupe près de 2000 scientifiques, issu·e·s de 174 instituts de 40 pays[3]. L’enjeu : étudier les propriétés du plasma de quarks et de gluons, état primordial de la matière qui aurait existé juste après le Big Bang. Rien que ça.
- Aux origines de l’univers
-
Les noyaux des atomes sont constitués de protons et de neutrons. Quand on les compresse ou qu’on les chauffe, la structure des protons et des neutrons disparaît et leurs constituants élémentaires forment un plasma quark-gluons : un état très particulier de la matière dans lequel ses constituants élémentaires sont déconfinés et qui aurait existé quelques fractions de secondes après le Big Bang. Les collisions d’ions lourds produites dans le l’anneau du Grand collisionneur de hadrons du CERN permettent de reproduire ce plasma quark-gluons. La collaboration « ALICE » en étudie les propriétés, pour comprendre comment il donne naissance aux particules constituant la matière de notre univers. Pour cela, elle utilise le détecteur ALICE – 10 000 tonnes, 26 mètres de long, 16 mètres de haut, 16 mètres de large –, installé dans une caverne à 56 mètres sous terre, près du village de Saint-Genis-Pouilly (France), où il reçoit les faisceaux du Grand collisionneur de hadrons.
Souriante, Sarah Porteboeuf-Houssais est à sa place, celle qu’elle avait rêvée enfant. « J’ai toujours eu un intérêt très poussé pour les sciences, le métier de chercheur était un idéal lointain, se souvient-elle. Ça m’attirait comme des tas de jeunes disent « je veux être acteur » ou « je veux être chanteur », mais ça me semblait inaccessible. » Abonnée à Science&Vie Junior puis à Ciel et Espace, la jeune adolescente ingurgite articles de vulgarisation et documentaires. « À l’époque, il y avait l’émission de télévision « C’est pas sorcier », je ne loupais jamais un épisode ! » Elle se passionne pour le savoir au sens large, l’histoire, l’égyptologie… et très vite la physique, en particulier la physique des particules et la cosmologie, sciences de l’infiniment petit et de l’infiniment grand. Ses parents l’encouragent à trouver sa voix et « à s’y donner à fond ».
Au lycée, un professeur de sciences de la vie et de la terre la convainc d’embrasser une carrière scientifique. Il l’inscrit au Concours général, une épreuve de haut niveau qui récompense chaque année les meilleurs élèves de première et terminale. « Le fait qu’un enseignant me dise « je crois en toi », ça a déclenché quelque chose. ».
Biais inconscients
À l’issue du bac, la jeune femme fait un choix singulier et pour le moins déterminé, contre l’avis même de certains professeurs : ce sera l’université, pas la prépa. « Mon choix n’était pas commun, reconnaît l’enseignante-chercheuse. Quand on est bonne élève, on est plutôt encouragé à aller en classe préparatoire. » Sauf que ce que veut l’étudiante, ce n’est pas préparer un concours, mais aller au contact de la recherche. « J’ai choisi l’université car je savais que c’était l’endroit où il y avait des chercheurs, que les gens qu’on avait devant nous, dès la première année, faisaient de la recherche, appartenaient à ceux qui font avancer les connaissances et sont dans les laboratoires. ».
Si elle reconnaît aujourd’hui que sa vision était un peu biaisée – « On fait de l’excellente physique en classe prépa ! » – elle ne regrette nullement son choix. L’université de Nantes lui offre une grande liberté, le terreau parfait pour s’épanouir. « Ça m’a permis de choisir ce que je voulais faire, ce que j’avais envie d’accomplir, de m’imposer mes propres objectifs. »
Après une licence de physique, elle opte pour un master en physique subatomique [aussi appelée physique des particules]. Décidée, elle est aussi très exigeante envers elle-même, voire intransigeante. « J’avais très conscience, dès le début, que c’était extrêmement difficile de continuer des études dans ce domaine, de faire une thèse et ensuite d’avoir un poste. Je me mettais énormément de barrières. Je me disais que si je montrais le moindre signe de faiblesse, ce n’était pas la peine de continuer. ».
Le milieu dans lequel elle évolue a beau être très masculin, elle y trouve sa place. « Je ne me suis jamais sentie discriminée parce que j’étais une fille. Mais il est vrai qu’il n’y en avait pas beaucoup. Mes amis blaguaient – parce qu’entre licence, master 1, master 2, les effectifs diminuent naturellement – et disaient que la proportion de filles augmentait parce que j’étais toujours seule et il y avait de moins en moins de monde autour ! ». Avec 17% de femmes, la physique – nucléaire et subatomique – reste très masculine. Qu’il existe des biais en défaveur des femmes, des stéréotypes de genre pouvant bloquer la carrière de jeunes chercheuses, elle en a pleinement conscience. « Je suis très sensible à cela vis-à-vis de mes étudiantes. Je vois beaucoup de jeunes filles douées, pas moins que des garçons, qui, arrivées en master, se posent 10 000 questions et se mettent naturellement des freins. ».
De la théorie à la mesure
Elle, ne s’en met aucun lorsqu’après une thèse théorique soutenue en 2009, elle décide de prendre un virage à 180°C et de poursuivre avec un post-doctorat expérimental. « C’est quelque chose qui n’est pas commun dans notre domaine. En général on s’oriente soit en théorie, soit en expérience, et on ne passe plus d’une catégorie à l’autre, car ça demande beaucoup d’efforts et donc beaucoup de volonté. Mais elle a réussi avec brio. Elle s’est imposée dans ce domaine en proposant des choses tout à fait remarquables, des mesures expérimentales… Ce n’est pas donné à tout le monde », salue Philippe Crochet, du Laboratoire de physique de Clermont-Ferrand (LPC).
Il faut dire qu’adolescente, elle imaginait le chercheur faisant tout – hypothèse, expérience, explication théorique, « et tant qu’à faire au passage il inventait une nouvelle façon de faire des mathématiques pour pouvoir expliquer les choses ! », plaisante-t-elle. Quinze ans plus tard, ce désir de compréhension globale ne semble pas l’avoir quittée : « J’ai exploité ce que j’avais développé en thèse pour proposer de nouvelles mesures, puis j’ai continué ce chemin en réalisant ces mesures et désormais en travaillant à la construction des détecteurs eux-mêmes. » Contrairement à ce qu’imaginait la petite fille, le travail de physicien est cependant loin d’être solitaire : la collaboration ALICE mobilise des centaines de chercheur·se·s. « Je suis en charge de la collecte de données de l’expérience. Actuellement, je suis tous les jours dans la salle de contrôle où je coordonne des équipes. Je dois être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. ».

Pas de côté
Dans le champ de l’enseignement aussi, la scientifique expérimente. En 2017, alors qu’elle crée une unité d’enseignement dédiée à la physique du chaos en troisième année de licence, elle propose une pédagogie de projet. « Ce n’est pas du tout classique ! Maintenant ça se fait de plus en plus, mais elle a été assez précurseuse chez nous », se souvient Philippe Rosnet, responsable de la licence de physique à l’UCA. Un an plus tard, elle organise la visite d’une centrale nucléaire pour ses étudiant·e·s de première année, puis des débats de société sur des questions controversées – l’arme nucléaire, l’énergie nucléaire et son intégration à la transition écologique, etc - « C’est quelqu’un qui n’hésite pas à bousculer les méthodes traditionnelles d’enseignement », ajoute le scientifique.
Ou comme le résume joliment sa collègue Marie Monier, qui enseigne à ses côtés, « Sarah a cette rigueur intellectuelle de ne pas figer les choses dans des cases mais de toujours réinterroger la place des choses. ».
[1] Équipe Particules et Univers du Laboratoire de physique de Clermont-Ferrand (LPC).
[2] A Large Ion Collider Experiment (ALICE) : détecteur spécialisé dans la physique des ions lourds installé sur l’anneau du Grand collisionneur de hadrons (LHC).
[3] Chiffres d’avril 2022.
|