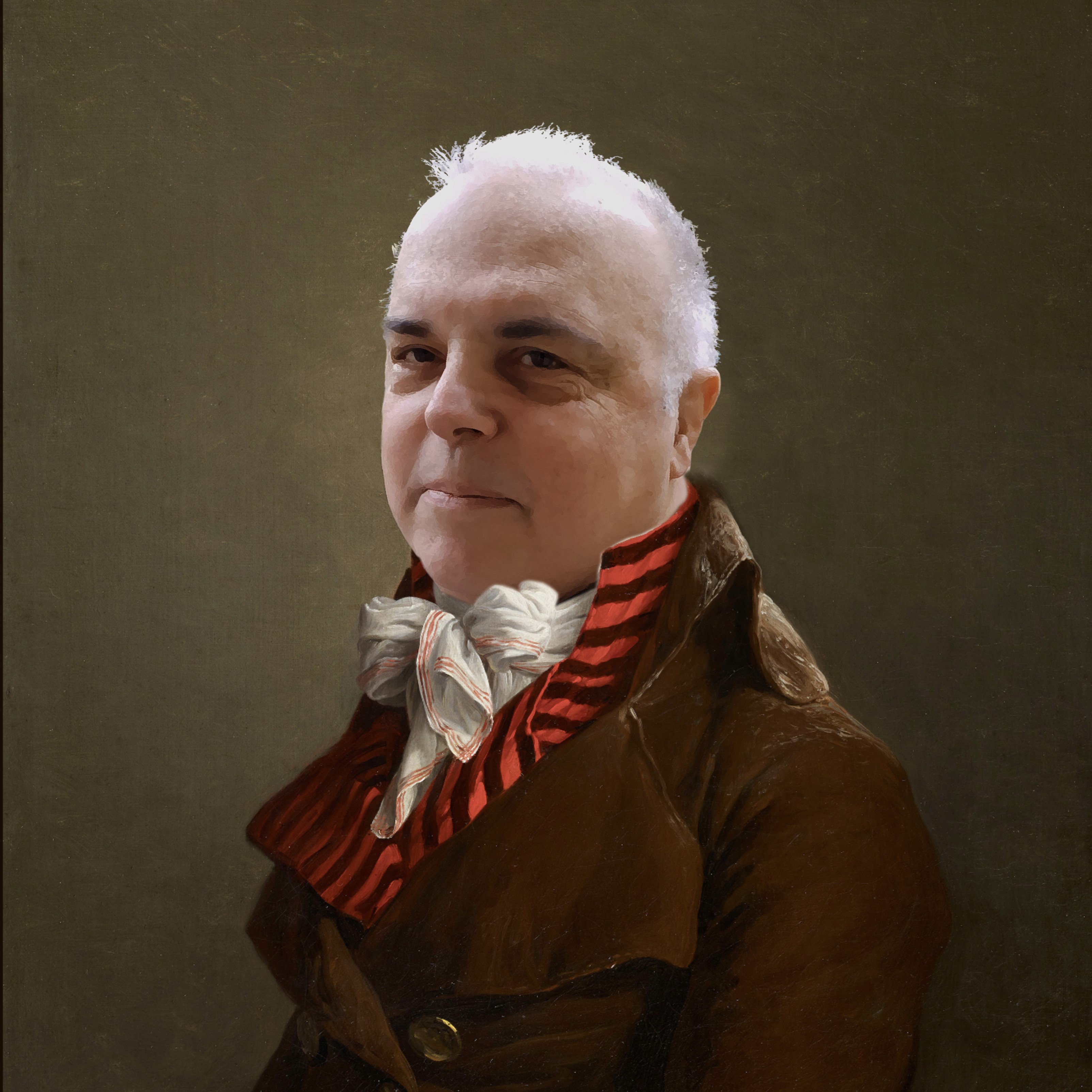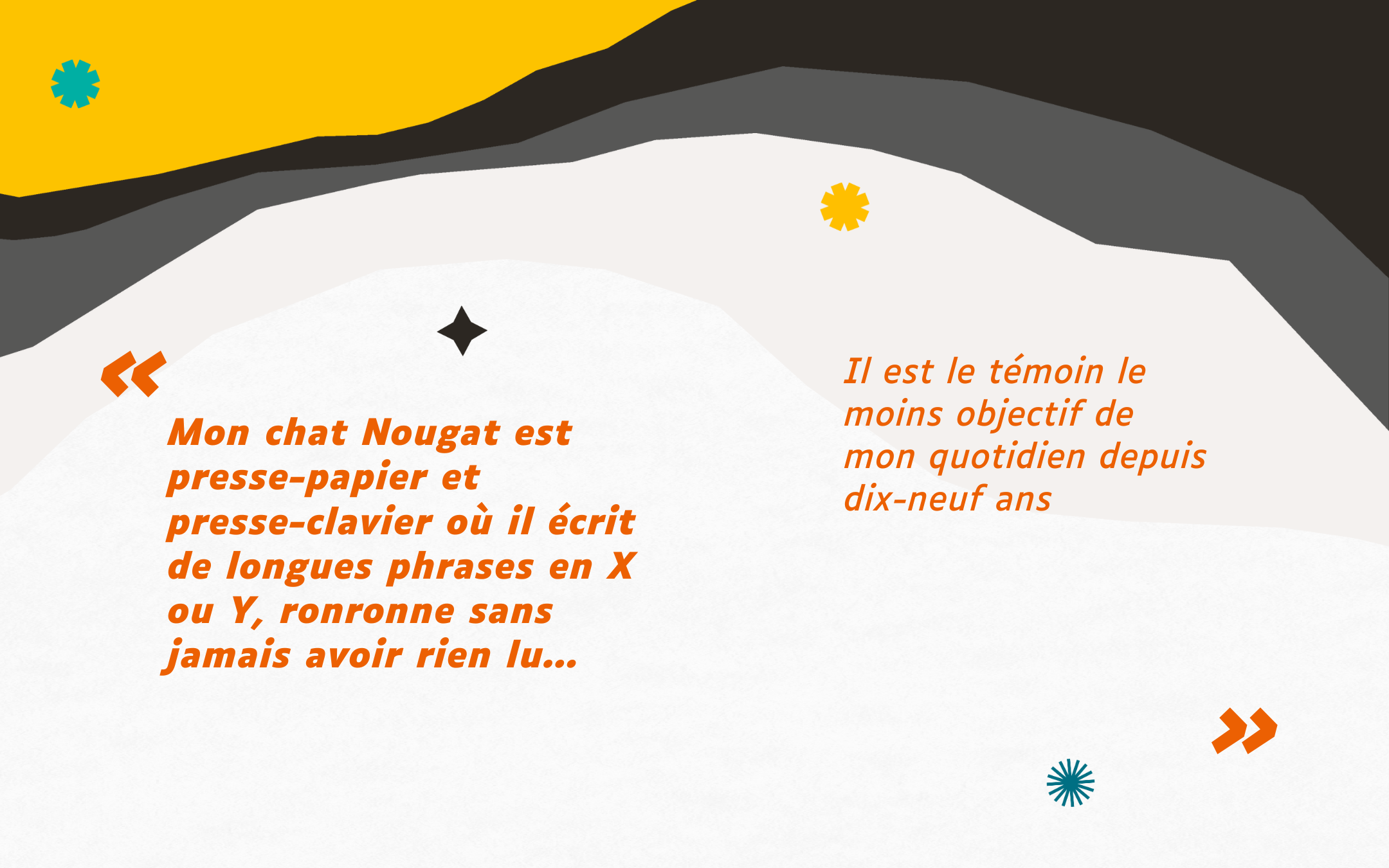Découvrez le portrait de l'inlassable explorateur de la Révolution française et du Premier Empire : Philippe Bourdin défend une histoire accessible sans être simpliste.

En ce jeudi 7 mars, le temps est doux, même un peu trop. Il est 15h. À Gergovia, où Philippe Bourdin
[1] nous a donné rendez-vous, règne une torpeur studieuse. Au quatrième étage, pas âme qui vive semble-t-il… Si, l’historien moderniste est déjà là, dans le bureau qu’il partage avec sa collègue Karine Rance. Il nous attendait. Pour parler d’histoire, celle de la Révolution française d’abord, son thème de prédilection, et puis la sienne un peu aussi. La Révolution française ? Presque une évidence, dès le lycée : «
Comment des hommes et des femmes pris dans une tourmente politique, sociale, militaire, réagissent-ils, recomposent-ils leur vie, se réunissent-ils ? C’est ce qui m’intéressait. J’aurais pu choisir une tout autre période, comme la seconde guerre mondiale pour me poser exactement les mêmes questions, mais il se trouve que l’histoire moderne me plaisait beaucoup. ».
C’est que le terreau familial est plutôt fertile dans ce champ-là. Ses parents, tous deux professeurs d’histoire-géographie, ont suivi les enseignements d’Albert Soboul, spécialiste de la période révolutionnaire et de Napoléon, dans les années 1960. Hasard ou pas, Philippe Bourdin aura lui aussi la chance, au cours de ses études, de suivre les cours du grand historien à la Sorbonne, au début des années 1980. «
Je trouvais qu’il y avait une complexité intéressante dans cette période », se souvient-il. Qu’il y ait un basculement d’un régime politique à l’autre, voilà qui n’est pas simple ! Comment construit-on une république après plusieurs siècles de monarchie ? La rupture est-elle totale ou y a-t-il des continuités ? «
Les hommes de 1789 ne rêvaient que très minoritairement à une république. Il a bien fallu que le pouvoir monarchique faillisse, que Louis XVI ne tienne pas tous ses engagements, qu’il cherche à fuir, à soulever des militaires émigrés ou étrangers contre la France, pour que la question de la république se pose de manière plus crue, mais toujours théorique ! On ne savait pas comment, véritablement, la fonder. Cela s’est fait en marchant… ».
Jeunesse politique
Son bac littéraire en poche, le jeune étudiant choisit les classes préparatoires : hypokhâgne, khâgne. La spécialité histoire n’existant pas à Clermont-Ferrand, il quitte la province pour Paris, où il intègre le lycée Louis Le Grand pendant deux ans, avant de poursuivre en licence à la Sorbonne. « Je ne regrette pas d’être parti, ça m’a apporté énormément. Culturellement, ça a été une rupture avec mon milieu provincial, cela m’a imposé de voir autre chose, d’autres profils sociaux, de m’acclimater à une capitale que j’aime par-dessus tout… C’était une formidable expérience humaine et intellectuelle », se souvient-il. Plongé dans le Paris de la fin des années 1970, le jeune homme vit « en direct » des événements politiques majeurs : l’émergence du programme commun de la gauche, la victoire de François Mitterrand aux élections présidentielles. « C’est une rupture intéressante dans l’histoire de la cinquième république. Nous étions aux premières loges, c’était plutôt enthousiasmant de vivre ces moments-là. »
De par sa culture familiale, Philippe Bourdin est déjà très politisé ; dans son entourage, nombreux sont les étudiants militants. « Nous débattions et avions parfois des jugements assez convergents sur les partis qui prétendaient nous accueillir et qui n’avaient pas forcément l’oreille très ouverte à ces jeunes qui étaient un peu foutraques, ou en tout cas… pas dans la ligne », se souvient-il avec amusement.
Devenu professeur certifié dans le secondaire, Philippe Bourdin revient en Auvergne et choisit de faire une thèse sur la sociabilité politique dans le Puy-de-Dôme : « Il s’agissait pour moi de comprendre comment, à l’époque de la Révolution française, s’étaient formées les opinions, à travers la lecture des journaux, les spectacles théâtraux, l’éducation civique, les fêtes... et comment les élections avaient été organisées, comment les opinions politiques s’étaient peu à peu mobilisées, soutenues par les journaux et les clubs politiques. » Il la soutient en 1993, à une époque où on pratique encore la monographie départementale[2] : « On allait volontiers dans les archives municipales, départementales, nationales, et on travaillait sur des sujets qui pouvaient correspondre à l’espace dans lequel on habitait et où on travaillait. »
Le sens du collectif
Recruté comme maître de conférences en 1994 à l’Université Blaise Pascal, l’historien devient professeur des universités en 1999 et endosse de nombreuses responsabilités au fil des années, au sein de l’université et au plan national[3] : directeur du Centre d’Histoire « Espaces et Cultures » (CHEC) de l'Université Clermont Auvergne (UCA), directeur-adjoint du service Université-Culture à l’UCA, président de la Société des études robespierristes (société savante de référence en France et dans le monde concernant l’histoire de la Révolution française), etc. « Il a un talent pour animer la recherche, les équipes, avec une vraie vision sur ce qu’on peut faire, il aime se projeter, voir en grand », décrit Karine Rance, maitresse de conférences en histoire contemporaine, qui le connaît depuis plus de vingt ans. « Il a un grand sens du collectif, une capacité à entraîner derrière lui, à dynamiser des projets, abonde son ancien étudiant, Cyril Triolaire, maître de conférences en études théâtrales à l’UCA. Et un souci permanent de passer le relai. »
Faux bruits
L’époque a changé, Philippe Bourdin s’y adapte sans mal, lui qui a enregistré en début d’année une vidéo Youtube consacrée à Lafayette, une première pour cet homme de lettres. « L’exercice me plait bien. Ces capsules sont un moyen très efficace d’aller à la rencontre du grand public, des scolaires. Plusieurs collègues du secondaire nous ont déjà dit combien ils les utilisaient, en totalité ou en partie, pour aborder certaines questions avec leurs élèves. » D’autres sont en préparation. Karine Rance n’est pas étonnée : « Il est curieux et il aime enseigner, transmettre. »
Mais si l’homme se plait à explorer de nouveaux modes de transmission des savoirs, pas question pour autant d’évacuer la complexité. « On a tendance aujourd’hui à offrir au grand public davantage d’idées reçues, convenues, que d’idées qui le perturberaient, qui le feraient réfléchir. Or les avancées vont systématiquement dans le sens d’une plus grande complexité. » Deux ans plus tôt, l’historien, décidément dans l’air du temps, dirigeait un ouvrage intitulé Faux bruits, rumeurs et fake news.
Au goût du jour
Philippe Bourdin ne raconte plus du tout la Révolution française comme il l’a apprise il y a plusieurs décennies. Pour cause : les connaissances ont évolué. Il s’astreint d’ailleurs à diffuser régulièrement ces « mises à jour » pour un large public, à travers des ouvrages de synthèse comme le volume Révolution, Consulat, Empire (1789-1815) de la collection Histoire de France éditée chez Belin en 2009, ou plus récemment un manuel pour les enseignants du secondaire co-écrit avec Cyril Triolaire, Comprendre et enseigner la Révolution française. Prolifique, il est l’auteur, le directeur ou co-directeur de plus de 40 ouvrages, auteur de près de 200 articles scientifiques… « Il est un des chercheurs les plus productifs sur les études révolutionnaires en France ces trente dernières années, admire Cyril Triolaire. Il est incontournable sur le sujet. »
Et critique sur la manière dont il est parfois abordé. Il regrette par exemple que les programmes scolaires se crispent encore sur certaines dates ou personnes. « Aucun choix n’est innocent. Par exemple, si l’on veut parler de l’histoire des femmes, on va aller chercher soit Mme Roland[4], soit Olympe de Gouges[5]. Or dans un cas comme dans l’autre, si intéressantes soient-elles l’une comme l’autre, elles ne sont pas symboliques véritablement de ce qu’a été le mouvement féminin sous la Révolution française, qui est un mouvement beaucoup plus populaire qu’elles ne le sont l’une et l’autre, car elles se sont faites au sein de salons bourgeois… » Auteure de théâtre, Olympes de Gouges est ainsi connue pour sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne rédigée en 1791, « un texte politique important pour nous aujourd’hui, mais qui à l’époque n’a pas eu d’impact ou quasi pas », rappelle-t-il.
Le théâtre, toute une histoire
On ne saurait dresser un portrait fidèle de Philippe Bourdin sans évoquer le théâtre, qu’il pratique depuis 35 ans en amateur et dont il est spécialiste de l’histoire[6]. « Je l’ai vu deux ou trois fois sur les planches ; à une époque, il jouait avec une troupe de l’Université [Les Tréteaux du Cabot teint], il était très impliqué », se souvient Karine Rance.
Grand amateur des États-Unis, de leur histoire comme de leur culture, il avait aussi envisagé – la Covid a interrompu son élan – d’y séjourner il y a quelques années, afin de voir comment le théâtre français de la fin du 18e et du début du 19e siècle s’était exporté Outre-Atlantique, au temps des grandes vagues d’immigration européenne. « J’ai tout de même accès à la presse américaine en ligne, à cette multiplicité de journaux qui marquent la démocratie américaine à la fin du 18e siècle... Donc ce n’est pas l’Atlantique, mais c’est quand même un océan qui s’ouvre à moi ! ».
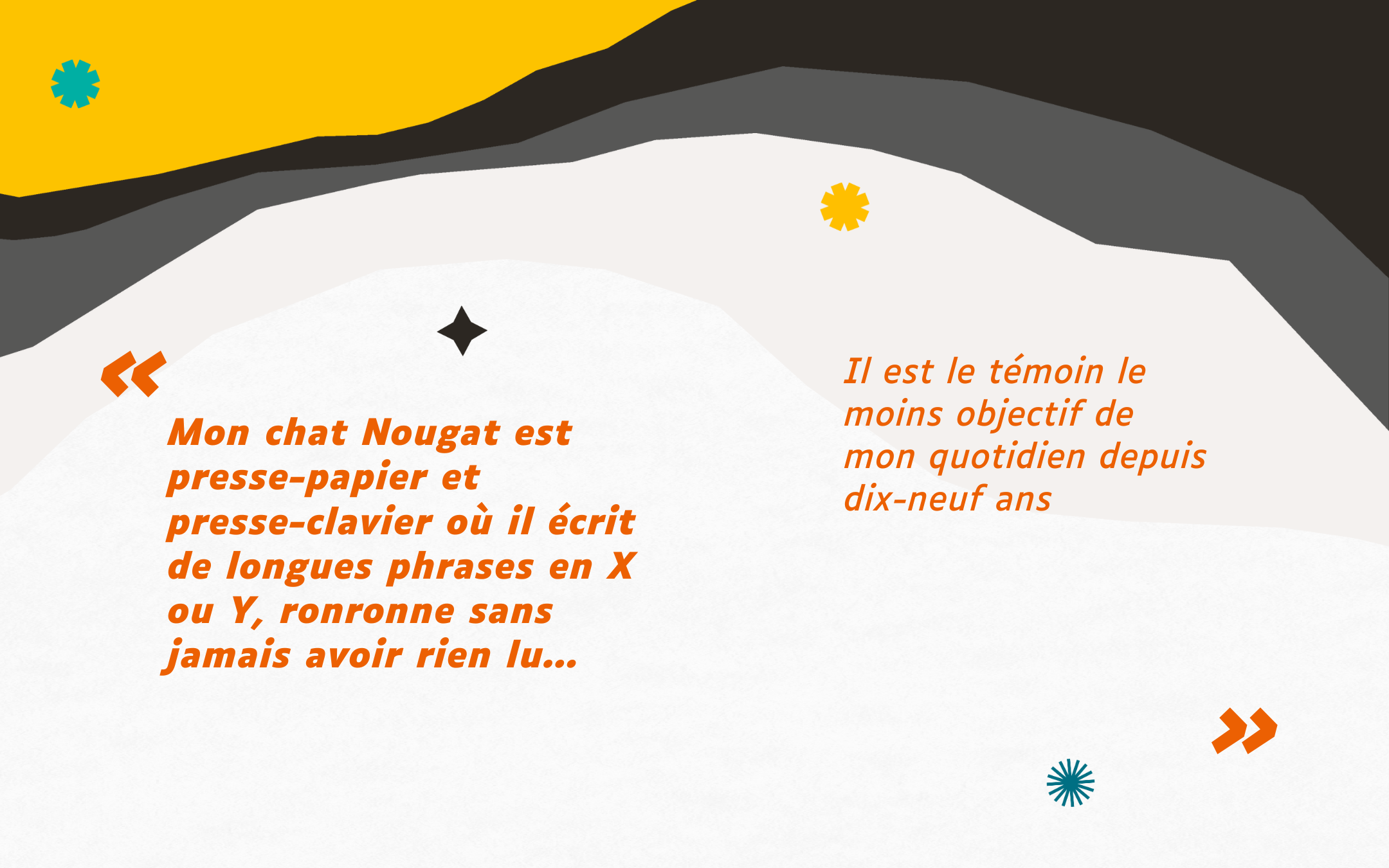
Savant mais accessible
Le chercheur a encore fort à faire avant la retraite – prévue dans deux ans : il travaille notamment à un manuscrit sur « l’Opéra de Paris pendant la période du directoire », projet initié avec l’Institut Universitaire de France (IUF) dont il est membre senior : « Je croule sous l’abondance des sources que je suis en train de traiter, mais enfin j’espère que cette année je vais pouvoir me mettre à l’écriture... »
L’ouvrage sera savant mais accessible, car « l’histoire c’est aussi de la littérature », rappelle cet amoureux des livres, qui envisage pourquoi pas, d’écrire un roman sitôt l’université quittée. « Ça me plairait assez. » Et même pourquoi pas… une BD ? « C’est prévu à la retraite ! Je suis un BDphile convaincu, j’en ai des centaines chez moi. Mais mes déceptions les plus grandes concernent la BD historique. La BD n’est pas faite pour faire un cours académique, pas du tout ! Il faut inventer un scénario spécifique à ce mode d’expression… » Et de citer le récent #J’Accuse…! de Jean Dytar publié aux éditions Delcourt, « d’une inventivité graphique formidable ».
Vite, vite, que la retraite arrive, on a déjà hâte de le lire.
|
[1] Spécialiste de l'histoire politique et culturelle de la Révolution française, et de l'histoire du théâtre. Toutes ses publications sont disponibles ici : https://uca-fr.academia.edu/PhilippeBOURDIN
[2] Une monographie départementale est une étude de cas sur un sujet d’histoire politique, sociale, culturelle ou (et) économique pour lequel est choisi un espace circonscrit à un département.
[3]Entre autres, directeur du Département d’Histoire (1994-95), directeur Centre d’Histoire « Espaces et Cultures » (2008-2020), directeur-adjoint du Service Université-Culture (1997-2006), membre du conseil scientifique de l’Université Blaise-Pascal (2002-2003), membre du Conseil national des Universités (2006, 2007, 2011-2015), membre du Comité des travaux historiques et scientifiques (depuis 2006), membre de la société du Conseil National du Livre (CNL) (2021-2024), membre senior de l’Institut Universitaire de France (IUF).
[4] Manon Roland, dite « Mme Roland », dirigeait un important salon dans Paris, où se réunissaient les principaux chefs des Girondins.
[5] Auteure de théâtre, écrivaine engagée, Olympes de Gouges est considérée comme une pionnière du féminisme en France.
[6] Philippe Bourdin a conduit des chantiers collectifs sur le théâtre et sur les spectacles de curiosités, qui se poursuivent et donnent lieu à deux bases de données.
|