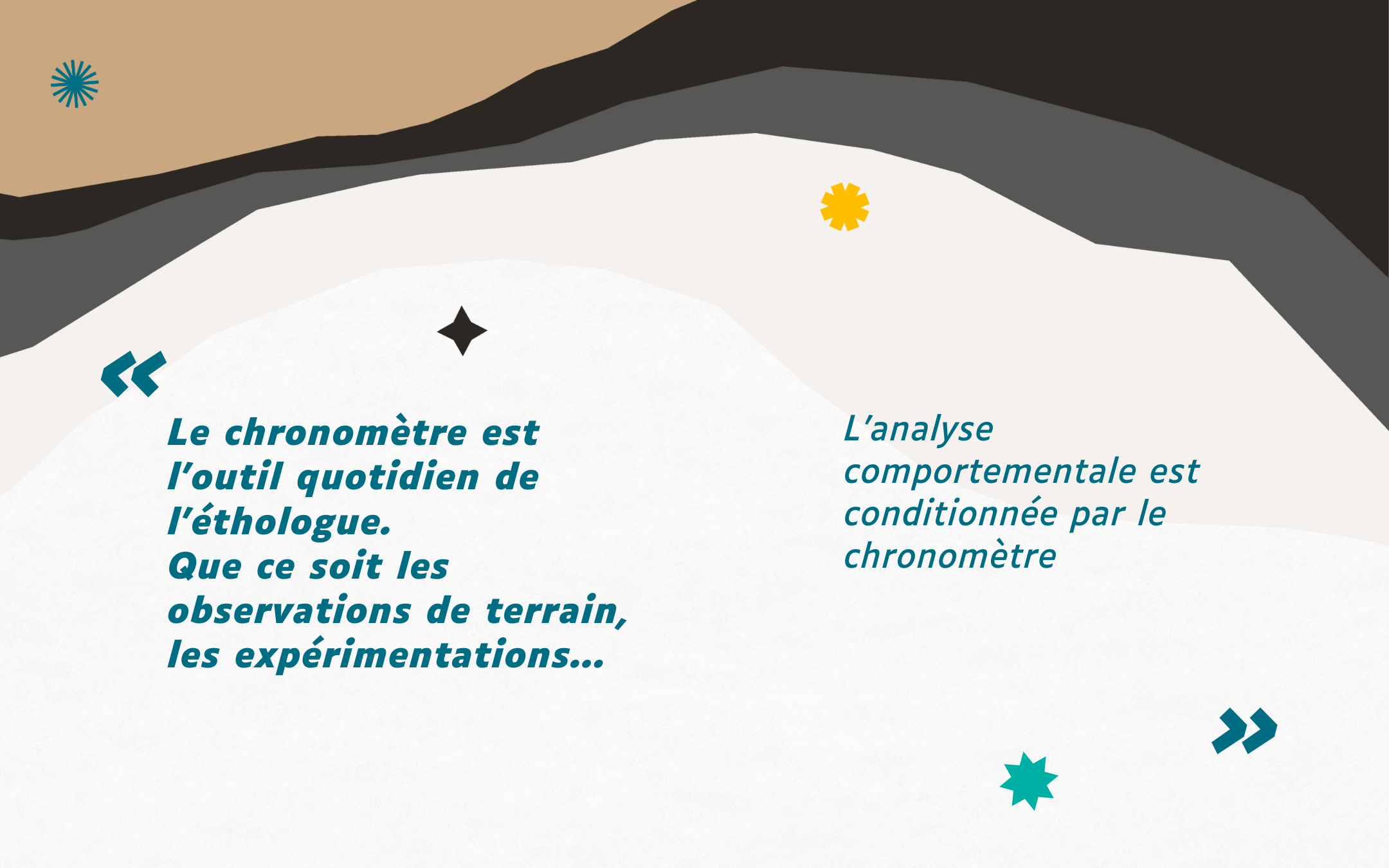Découvrez le portrait de Nadège Aigueperse, chercheuse en éthologie. Fine observatrice des comportements animaux, elle explore l’adaptation des ruminants à leur milieu et à l’Homme, au sein de l’équipe CARAIBE (UMR Herbivores, INRAE).

Deux loups sagement posés sur une table m’accueillent, alors que je franchis les portes du bureau de Nadège Aigueperse. Ces répliques de plastique ont beau être inoffensives, elles ont de quoi surprendre. Des loups ? Dans une unité dénommée « herbivore » dédiée à l’étude des ruminants ? « Ils servent dans le cadre de mes expériences sur les moutons, pour générer de l’anxiété », justifie dans un sourire la jeune chercheuse, qui m’invite à m’asseoir. Et tandis qu’elle se raconte, je comprends que ces loups ont, bien plus qu’on ne pourrait le penser au premier abord, toute leur place dans son parcours de recherche.
Loup y es-tu ?
Car les prédateurs fascinent la jeune femme depuis des années. Peut-être même sont-ils à l’origine de sa passion pour le comportement animal. Elle les découvre enfant à la télévision, dans des documentaires animaliers : « Je les regardais chasser en groupe, cela m’intriguait, je me demandais : « Mais comment arrivent-ils à se coordonner ? Ils ne parlent pas – c’est du moins ce que je croyais – et pourtant ils y arrivent, ils se comprennent… c’est fou ! »
Dès le collège, sa décision est prise : elle veut faire de l’éthologie, étudier le comportement de ces animaux captivants. Au lycée, ses professeurs l’orientent logiquement vers une prépa véto. Hors de question pour la jeune fille, qui connaît ses limites pour avoir vécu avec des animaux de compagnie et fréquenté les cabinets vétérinaires. « J’avais conscience qu’un vétérinaire devait prendre des décisions que je ne pourrais pas psychologiquement prendre. » Sans compter qu’elle n’aime pas les aiguilles. Et craint l’esprit de compétition : « Ça ne m’intéressait pas de me bagarrer avec les autres pour avoir une place. »
Ce qu’elle souhaite, c’est observer les animaux, sans forcément interagir fortement avec eux. « Ce que j’aimais, c’était les regarder faire, comprendre pourquoi ils faisaient telle ou telle chose, comment ils avaient appris à le faire. » Face au sempiternelle refrain « Il n’y a pas de débouché… », elle tient bon et s’inscrit en première année de licence Biologie des organismes à Limoges. Mais très vite, ce choix s’avère décevant : en première année, les sciences animales ne sont quasiment pas abordées.
Influence maternelle
Soutenue par sa mère, elle change de cap pour Rennes, où l’éthologie est présente dès la première année. Elle ne quittera plus la cité bretonne jusqu’à son master 2 recherche « Comportement animal et humain ». « Après… ça a été un peu chaotique », se souvient-elle. La jeune étudiante a l’opportunité, pour son stage de master, de travailler dans l’équipe de Raymond Nowac, à INRAE de Tours. Elle y étudie l’influence des odeurs prénatales sur le comportement alimentaire des jeunes poules, avec Aline Bertin. Et découvre le vaste domaine de recherche qui sera désormais le sien : l’influence maternelle sur le développement du jeune.
Mais l’idée de travailler sur les prédateurs ne l’a pas quittée. Pour sa thèse, elle rêve d’aller à Reims, dans un laboratoire qui étudie les renards et les chats harets
[2] et sauvages. Malentendante, elle constitue un dossier spécifique auprès du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Sans succès. Obstinée, elle prend une année sabbatique pour peaufiner son dossier et le présenter à nouveau l’année suivante. Parallèlement, l’Université de Rennes la contacte, l’éthologiste Sophie Lumineau souhaite monter un projet avec elle, pour étudier l’influence du comportement maternel sur le développement du jeune chez la caille. «
Pour obtenir une bourse de thèse, on ne doit pas dépasser deux ans post-master, donc je savais que je n’avais plus trop d’options, il était risqué d’attendre, raconte la jeune chercheuse.
J’ai grandi un peu, et je me suis dit pourquoi pas. »
Chaos fertile
Renoncer aux prédateurs s’avèrera être le bon choix : la jeune femme décroche une bourse pour le projet rennais. Elle ne nourrit aucun regret : « Le bagage que j’ai aujourd’hui me permet de comprendre les comportements, que ce soit chez le prédateur ou d’autres animaux. Les techniques d’apprentissage par essai-erreur, imitation, innovation… sont communes, même si elles se mettent en place différemment selon les espèces. Si je veux savoir comment font les prédateurs, je peux fouiller, poser les questions aux bonnes personnes »… ou intégrer des loups dans une expérimentation sur l’anxiété chez les moutons !
Les ruminants sont désormais son modèle privilégié d’étude. Recrutée en 2017 à INRAE, au sein de l’équipe CARAIBE[3] (UMR herbivores), elle passe d’abord un an au Québec à l’Université McGill, dans le laboratoire d’Elsa Vasseur. Elle y travaille sur le bien-être des vaches laitières, auxquelles il faut réapprendre… à marcher. La nouvelle réglementation impose en effet de sortir régulièrement les animaux – jusqu’ici attachés en permanence – dans des aires d’exercice. « Comment les sortir pour qu’elles ne se blessent pas ? Et en même temps, veulent-elles sortir ? interroge l’éthologiste. Avant de vouloir quelque chose parce que c’est bien, il faut d’abord poser la question à l’animal. On cherche à remettre les animaux dehors, mais avec toute la sélection qu’on a faite, certains ne sont plus très adaptés. Ce n'est pas le tout de les mettre dehors, encore faut-il trouver un moyen de le faire ça dans de bonnes conditions. » C’est le début d’une vaste exploration du concept de « robustesse comportementale », son sujet de prédilection.
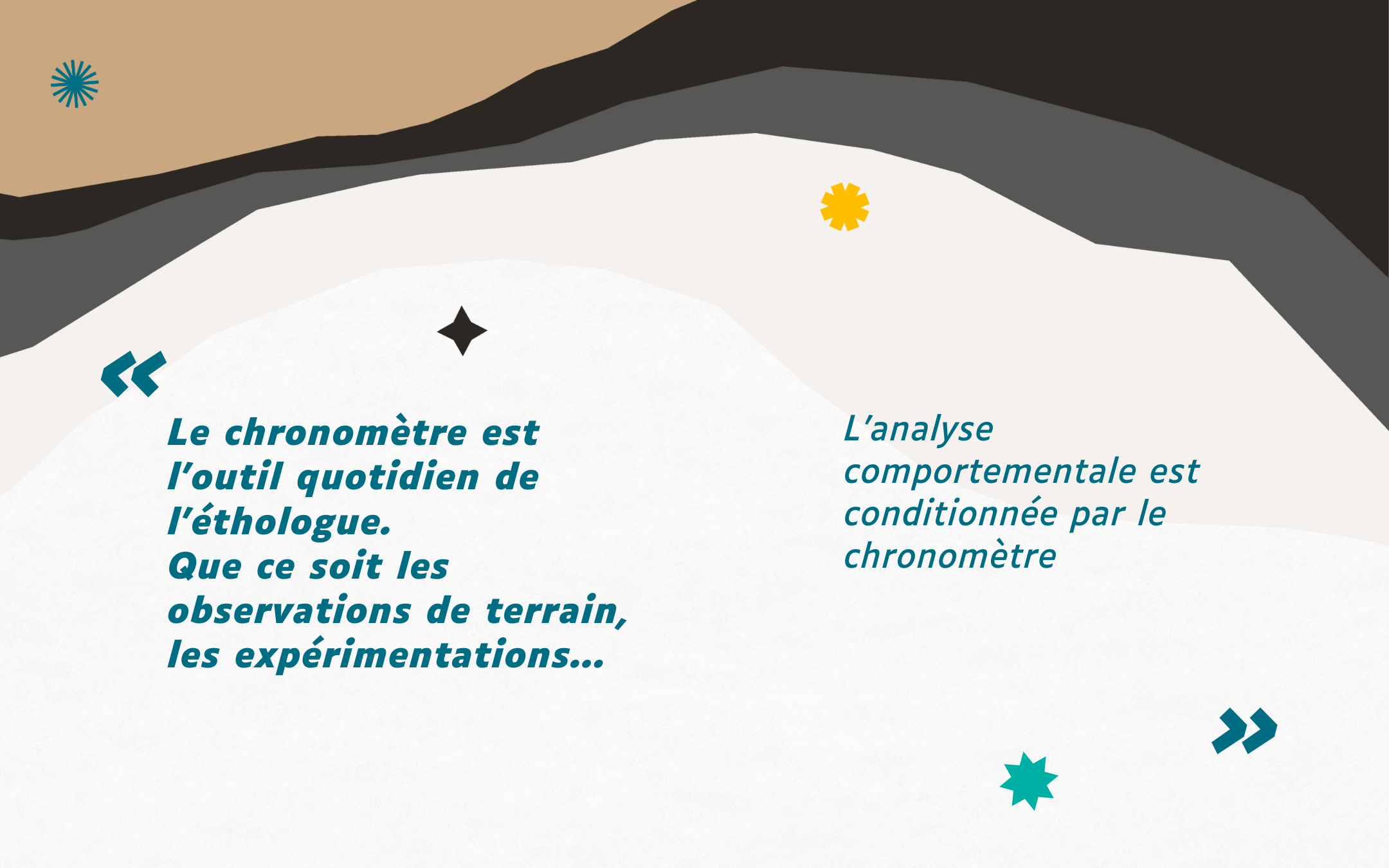
Des animaux et des Hommes
« On est dans un contexte d’élevage, donc l’animal doit être adapté à son milieu certes, mais il ne doit pas non plus être trop indépendant, on attend de lui une certaine docilité. C’est cela la robustesse comportementale, un mélange d’adaptation au milieu et d’adaptation à l’Homme. »
Dans l’équipe, chacun est dédié à un sujet (la relation Homme-animal, le comportement alimentaire…), avec un objectif commun : faire en sorte que l’animal soit bien, et l’Homme également. Elle, étudie plus spécifiquement le développement de la robustesse au jeune âge, l’influence de la mère chez le veau, mais aussi chez le chevreau et l’agneau. Pour ce faire, elle navigue entre plusieurs sites expérimentaux – Theix (Puy-de-Dôme), Marcenat (Cantal), Laqueuille (Puy-de-Dôme), Bourges (Cher), Mirecourt (Vosges), La Fage (Larzac) –, qui lui donnent accès à différents modes d’élevage. Dans le Larzac, il est intégral : les agneaux sont dehors dès la naissance. À Marcenat, les veaux grandissent « sous la mère », à Mirecourt « sous nourrice » ... « Nadège est très créative, elle a plein d’idées, imagine sans arrêt des dispositifs de test…, décrit sa collègue Marie-Madeleine Richard, ingénieure de recherche. Ce qu’elle dit souvent, c’est qu’il faut poser la question à l’animal et voir comment il répond. J’apprends beaucoup avec elle. C’est une éthologiste passionnée, qui apporte beaucoup à l’équipe ».
À bien y réfléchir, l’attention pour le bien-être animal a toujours été là. Du collège à ses années rennaises, Nadège Aigueperse a été bénévole dans un centre de soins pour la faune sauvage. Elle y passait ses mercredis, une partie de ses vacances.
C’est donc en tout logique que devenue chercheuse spécialiste du bien-être animal, elle intègre le Comité d’éthique pour l’expérimentation animale d’Auvergne (C2E2A). Sensible aux conditions de vie des animaux de laboratoire, elle interroge sans relâche : « Pourquoi ne les met-on pas en groupe ? Y a-t-il une raison ? Est-ce acceptable ou pas ? Quand je vois « enrichissement » et qu’on met juste un tunnel pour une souris… C’est le minimum ! Je n’appelle pas ça enrichissement, c’est la base… » Elle se sait pointilleuse : « Je pense que les gens me trouvent pénible ! »
« Nadège peut paraître exigeante, mais c’est parce qu’elle est hyper rigoureuse, avec une capacité de travail phénoménale, admire Marie-Madeleine Richard. Cette rigueur, elle la transmet aux étudiants, en les guidant sans jamais faire le travail à leur place ».
Observer pour comprendre
Son handicap a-t-il participé à orienter ses choix ? Certainement. Atteinte d’une dégénérescence du système auditif qui a débuté à la puberté, lui faisant perdre entre l’âge de 13 et 20 ans 80 à 90% de son audition, la jeune femme se détourne vite des sons. « Je ne pouvais pas travailler sur les chants, les vocalisations… Ayant eu très tôt cette perte, je ne m’y suis pas intéressée, mais je ne me sens pas lésée pour autant. Car quand on n’entend pas, que fait-on ? Eh bien on observe. » Opérée d’une oreille, Nadège Aigueperse entend bien aujourd’hui, même si elle ne peut pas situer les sons, et lit sur les lèvres. « Tout ce qui est expression faciale me parle beaucoup. Parfois je me dis : « cet animal n’est pas comme d’habitude, il ne fait pas la même tête, ça ne va pas » » Et d’ajouter dans un sourire : « Aurais-je été aussi observatrice sans mon handicap ? Je ne le saurai jamais. Mais en tout cas m’asseoir dans un coin et observer, ça me va bien. ».
|
[1] L’éthologie est l’étude du comportement animal.
|