Blaise Pascal, le génie intranquille
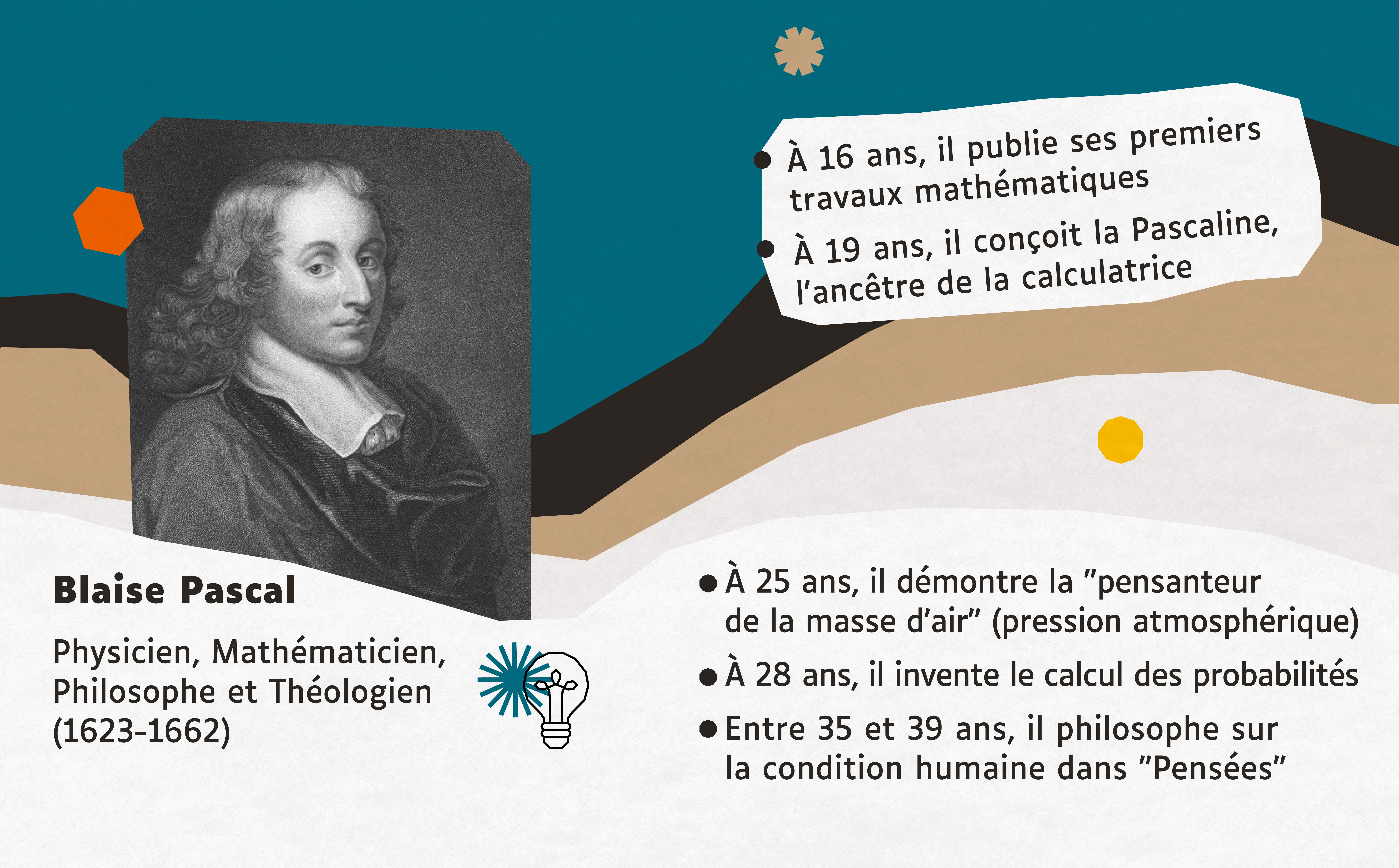
Physicien, génial mathématicien, autodidacte, polémiste, homme d’affaires, philosophe, fervent chrétien… Pascal fut un génie aux multiples visages.

Physicien, génial mathématicien, autodidacte, polémiste, homme d’affaires, philosophe, fervent chrétien… Pascal fut un génie aux multiples visages.
Assis à son bureau, penché sur une liasse de feuilles manuscrites, l’homme est immobile, visiblement concentré, la respiration à peine perceptible. D’un geste de la main, il nous intime au silence. Le temps soudain, semble suspendu dans l’appartement parisien, rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel. Après quelques minutes d’éternité, Blaise Pascal se redresse enfin. Il ne sourit pas, mais son regard est doux, empreint de tristesse. En cette matinée d’octobre, les migraines lui laissent un peu de répit. Alors sans empressement, il se raconte ... Ainsi aurait pu avoir lieu cette rencontre imaginaire.
« En écrivant ma pensée, elle m’échappe quelque fois1 », regrette-t-il. À 36 ans, le génial savant, connu dans toute l’Europe pour ses découvertes, souffre d’un mal que les médecins ne savent nommer. Il ne s’en plaint pas, donne même un sens à sa souffrance2.
Il faut dire que la douleur l’accompagne depuis des années. Quasiment depuis sa naissance, le 19 juin 1623 à Clermont-en-Auvergne. Enfant, se souvient sa sœur Gilberte, il est régulièrement secoué de violentes convulsions à l’hôtel de Vernines où il habite alors, près de la cathédrale. Ce qui ne l’empêche pas de montrer une précocité exceptionnelle, que détecte vite son père.
La recherche des raisons
Issu de la bourgeoisie de province, ayant perdu sa mère très jeune, Blaise Pascal est en effet élevé par son père, Etienne Pascal, un homme cultivé et aimant, féru de sciences, de mathématiques et de langues anciennes.
Comme ses sœurs, Gilberte et Jacqueline, il ne va pas à l’école, ce qui n’est pas courant à l’époque pour les garçons. Leur éducation est orale, basée sur le raisonnement. « Il souhaite éveiller et cultiver chez ses enfants le désir de comprendre, de trouver eux-mêmes une réponse, de réinventer un savoir », raconte Jacques Attali, qui à sa manière, a rencontré ce grand savant3. En grandissant, Blaise prend goût aux démonstrations infaillibles : « Quand on ne lui donnait pas de bonnes raisons, il en cherchait lui-même […] », se souvient sa sœur Gilberte4.
Le père veut le meilleur pour son fils prodige, qu’il ait notamment accès aux cercles scientifiques les plus prestigieux de la capitale. La famille déménage donc à Paris, dans le quartier du Temple. Blaise a 8 ans.
Premières découvertes
Là, l’enfant se passionne pour les mathématiques. La légende familiale veut qu’un soir, en rentrant d’une réunion chez Marin Mersenne – un religieux et mathématicien qui animait à l’époque la société savante Academia parisiensis – le père trouve son fils « assis par terre, ‘‘absorbé dans la contemplation de cercles, angles et parallèles5’’. Blaise ‘‘avoue à son père être en train de démontrer que la somme des trois angles d’un triangle est égale à celle d’un angle plat5’’ », rapporte Jacques Attali. Il semblerait que l’enfant redécouvre, par lui-même, la trente-deuxième proposition des Éléments d’Euclide ! À 12 ans et demi, il est autorisé à assister aux séances de l’académie Mersenne, où il fréquente de grands mathématiciens, tel Roberval et Pierre Gassendi.
Quatre ans plus tard, à 16 ans, il publie ses premiers travaux mathématiques – un bref Essai sur les coniques – et invente au passage, s’inspirant des travaux du géomètre Girard Desargues (1591-1661), une nouvelle branche de mathématiques, la géométrie projective. « Personne avant deux siècles n’en comprendra les extraordinaires débouchés possibles : tracer les plans des machines3. »
Non sans fierté, Blaise présente son « théorème de Pascal » (ou « hexagramme mystique ») devant l’Académia. « Ce garçon, dit l’un des Académiciens, produit plus de corollaires qu’un prunier ne porte de prunes3. » « On disait que, depuis Archimède, on n’avait rien vu de cette force », rapporte Gilberte. Descartes en est même jaloux dit-on…
La machine d’arithmétique
À 18 ans, Blaise continue d’étudier les mathématiques, mais il veut aider son père, qu’il a suivi à Rouen. Celui-ci a en effet obtenu du cardinal de Richelieu, principal ministre d’État de Louis XIII, une charge importante : il est désormais « commissaire député de Sa Majesté pour l’impôt et la levée des tailles ». Une charge lourde : pour collecter les impôts, il doit réaliser des calculs laborieux. Blaise imagine les automatiser, en concevant une « machine d’arithmétique », qu’il met au point entre 1642 et 1644. « Il existait déjà des ancêtres de nos calculatrices, mais aucune ne pouvait, avec infaillibilité, faire des calculs qui intègrent correctement les retenues des additions. C’est en cela que consiste vraiment l’invention de Pascal6 », souligne Pierre Lyraud, qui a consacré une thèse au grand savant.
Pascal se fait entrepreneur et entend commercialiser sa « Pascaline » ; il en fait même la publicité dans un prospectus7 : « Ami lecteur, cet avertissement servira pour te faire savoir que j’expose au public une petite machine de mon invention, par le moyen de laquelle seul tu pourras, sans peine quelconque, faire toutes les opérations de l’arithmétique et te soulager du travail qui t’a souventes fois fatigué l’esprit lorsque tu as opéré par le jeton ou par la plume ». Sans succès : la machine est trop chère et trop complexe à produire.
Controverse sur le vide
Le jeune homme ne s’arrête pas en si bon chemin. En 1647, à 24 ans, il entend parler de « l’expérience italienne » du physicien et mathématicien Evangelista Torricelli (1608-1647) : Un tube rempli de mercure, dont une extrémité est bouchée avec un doigt, est renversé dans une cuve elle-même remplie de mercure. Le métal dans le tube descend alors un peu, mais pas complètement, laissant un espace apparemment vide en haut. De quoi déclencher une vive controverse scientifique et religieuse : le vide existe-t-il ? Pour les jésuites, qui l’associent au néant, c’est inconcevable !
Blaise Pascal lui, pense qu’en haut du tube, il y a bien le vide, et que la hauteur du mercure ne fait que compenser la pression exercée par l’atmosphère sur la cuve. L’air aurait donc un poids, ce que nombre de savants admettent à l’époque, sans jamais l’avoir démontré. En 1647, le jeune savant commence à réaliser des expériences pour démontrer ses dires. Il en imagine surtout une déterminante, celle « du Puy-de-Dôme » : elle consiste à observer le comportement du tube de Toricelli en bas et au sommet, afin de vérifier que la colonne de mercure diminue dans le tube à mesure qu’on s’élève et que la pression de l’air diminue…
L’expérience du puy de Dôme
Trop malade, Blaise confie à son beau-frère Florin Périer le soin de réaliser l’expérience. C’est chose faite le 9 septembre 1648 : Un changement d’altitude entraîne bien un changement de pression dans l’atmosphère, mesurable par la variation de hauteur du mercure dans le tube. « La pesanteur de la masse d’air est la véritable cause de tous les effets que l’on avait attribués jusque-là à cette cause imaginaire8 », observe le jeune savant. À 25 ans, Pascal a démontré que le vide existe et pose les bases de la physique expérimentale !

Jeux de hasard
Ses expériences attirent l’attention de toute l’Europe savante. Une période féconde s’ouvre pour le jeune scientifique : « En trois ans, il va inventer le calcul des probabilités, découvrir les principes du calcul infinitésimal et intégral, mettre au point sa théorie du vide et commencer à esquisser un livre sur la condition humaine3 », qui deviendra les Pensées.
En 1652, Blaise est seul à Paris, son père est mort l’année précédente, sa sœur Jacqueline est entrée au couvent à Port-Royal de Paris. Il fréquente les salons parisiens, découvre la vie mondaine, les cercles de jeux et… le « problème des partis », un problème mathématique portant sur les jeux de hasard qui lui inspire une « géométrie du hasard » : à 28 ans, il découvre comment évaluer et maîtriser les risques, et invente le calcul des probabilités. « Je le crois capable de résoudre n’importe quel problème3 », dira de lui Fermat, de vingt ans son ainé.
Rupture
Mais bientôt le dégoût du monde le saisit. Comment concilier recherche et foi ? s’interroge-t-il. Après ce qu’il décrit comme sa « nuit de feu » en novembre 1654, Blaise Pascal se rapproche de Dieu, approfondit sa connaissance de la Bible, tout en poursuivant ses réflexions scientifiques et méthodologiques, travaillant sur deux œuvres majeures : l’Abrégé de la vie de Jésus-Christ et De l’Esprit géométrique. Plusieurs personnalités semblent désormais coexister en lui. Sous le pseudonyme de Louis de Montalte, l’une d’elle se veut polémiste et rédige « Les Provinciales », 18 lettres contre le laxisme des jésuites et leurs contradictions dans le domaine de la grâce. Défenseur de Saint-Augustin, Blaise Pascal soutient la doctrine janséniste9. « Sur le plan littéraire, c’est indéniable, Pascal a écrit un chef-d’œuvre de la littérature polémique, aussitôt admiré », relève Pierre Lyraud. Les Provinciales sont le plus grand succès de librairie de l’Ancien Régime.
Fascination de l’infini
Pendant les cinq dernières années de sa vie, entre 35 et 39 ans, Blaise Pascal semble mener six vies simultanées, malgré de régulières et terribles attaques de sa maladie, qui le laissent chaque fois épuisé. « Le scientifique travaille à la théorie des probabilités et au calcul intégral en veillant à protéger jalousement ses découvertes ; le polémiste ferraille avec les jésuites et le pape ; le philosophe produit une réflexion désespérée sur la condition humaine […] ; l’entrepreneur invente les transports en commun10 et défend ses intérêts d’actionnaire dans les marais poitevins11 ; le pédagogue enseigne aux enfants des plus grands ; enfin, Blaise se prépare à mourir dans l’obsession de l’humilité et du salut…3 »
Il est maintenant connu dans toute l’Europe, comme l’inventeur de la machine d’arithmétique et l’auteur des Expériences touchant le vide.
Les Pensées
Sur la fin de sa vie, son grand livre sur la condition humaine est désormais au centre de ses préoccupations : pour lui, la condition de l’homme est désespérée, ses contradictions ne peuvent être résolues sans le recours à la révélation chrétienne. « Deux excès : exclure la raison, n’admettre que la raison12. »
Références1. Blaise Pascal, Pensées, série XXV2. « Prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies » 3. Jacques Attali, Blaise Pascal ou le génie français 4. Gilberte Périer, La vie de Monsieur Paschal, escrite par Madame Perier, sa sœur, femme de Monsieur Perier, conseiller de la Cour des Aides de Clermont, 1663 5. Marguerite Périer, Mémoire de la vie de Monsieur Pascal, Paris, 1854 6. Pierre Lyraud, Pascal, Les éditions du Cerf, 2023 7. Avis nécessaire à ceux qui auront curiosité de voir la machine d’arithmétique et de s’en servir 8. Blaise Pascal, Discours sur la religion et sur quelques autres sujets 9. Les jansénistes prônent une vie de renoncement à tout ce qui n’est pas la foi 10. Un réseau de carrosses accessible au public circulant à intervalles réguliers selon des itinéraires précis, avec stations et changements. 11. En mars 1654, Blaise Pascal rejoint la société d’assèchement des marais poitevins. Les terrains à assécher présentent une faible pente, Pascal invente donc la presse hydraulique pour élever l’eau et mieux la canaliser. 12. Blaise Pascal, Pensées, fragment Soumission et usage de la raison 13. Blaise Pascal, Pensées, fragment Contrariétés |

