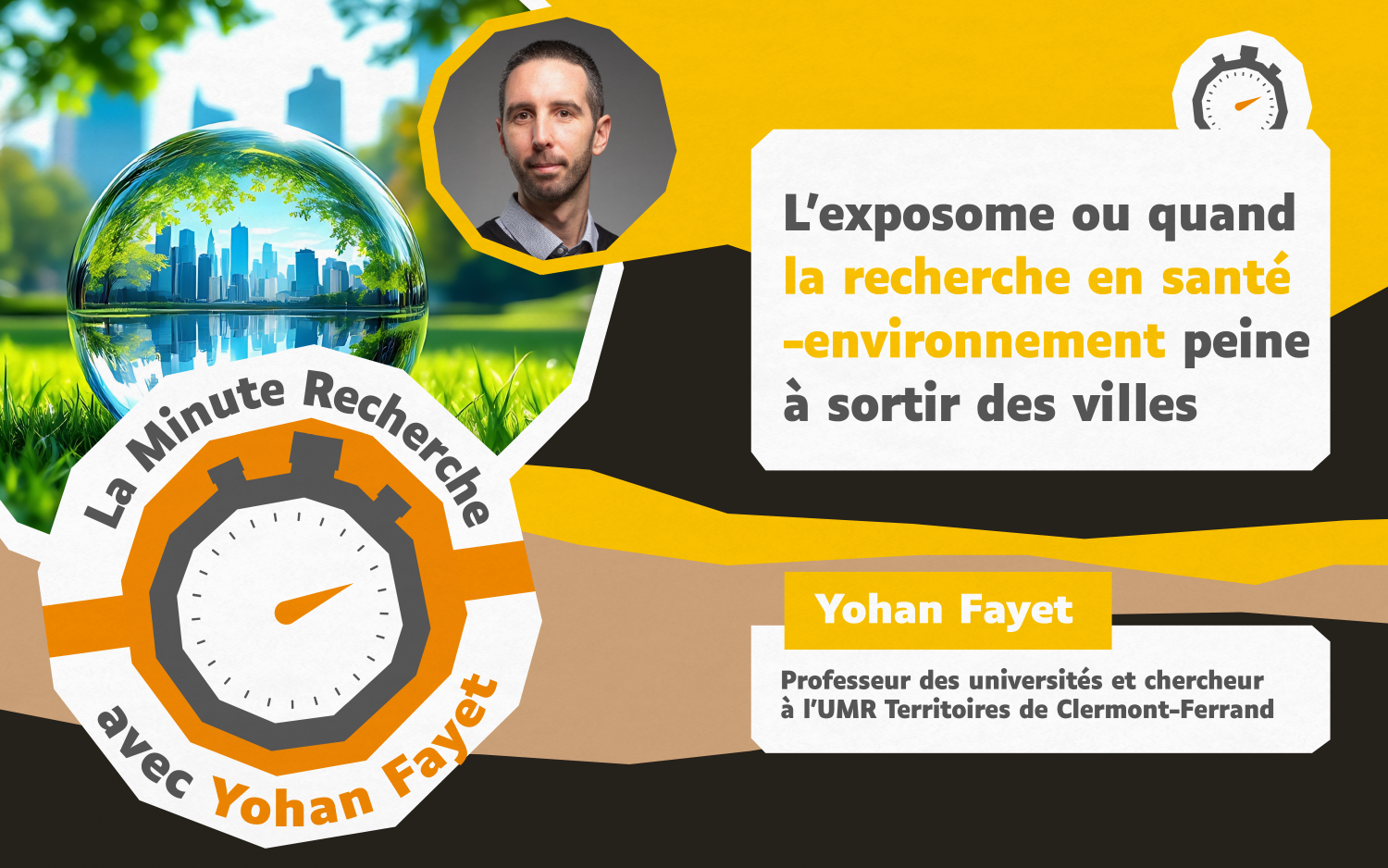Publié le 19 juin 2025 – Mis à jour le 10 septembre 2025
Minute Recherche - Concept novateur visant à regrouper l’ensemble des expositions auquel est soumis un individu durant toute sa vie, l’exposome promet de révolutionner les connaissances sur la relation santé-environnement grâce à l’analyse croisée de grandes quantités de données
Concept novateur visant à regrouper l’ensemble des expositions auquel est soumis un individu durant toute sa vie, l’exposome promet de révolutionner les connaissances sur la relation santé-environnement grâce à l’analyse croisée de grandes quantités de données. Mais où serait-on vraiment capable de la mettre en pratique ? Une étude interdisciplinaire montre que la disponibilité limitée des données d’expositions semble pour l’instant inciter les recherches sur l’exposome à se focaliser sur les milieux urbains.
Mieux comprendre le rôle de l’environnement et de nos modes de vie sur la santé : telle était l’idée de Christopher Wild quand il a inventé en 2005 le concept d’exposome. Regroupant la totalité des facteurs environnementaux et comportementaux auxquels un individu est exposé durant toute sa vie et qui ont une influence sur sa santé, ce concept est aujourd’hui au cœur d’un véritable engouement scientifique et politique. Pour preuve, la Commission européenne a soutenu en 2020 la mise en place de l’EHEN (European Human Exposome Network), un réseau de 9 programmes de recherche européens dédiés à l’exposome et financé à hauteur de 100 millions d’euros. La mission des études de l’EHEN était de contribuer à l'ambition politique du Pacte Vert européen : « protéger la santé et le bien-être des citoyens contre la pollution et la détérioration de l'environnement ».
 Ensemble des expositions inclues dans l’exposome sur l’ensemble de la vie
Ensemble des expositions inclues dans l’exposome sur l’ensemble de la vie
Un concept spatialement limité
Nourri de promesses intégratives (regrouper le maximum d’individus, d’expositions, d’outils et de disciplines scientifiques) et de soutiens politiques et financiers, l’exposome se présente comme l’avant-garde des recherches en santé-environnement croisant données biologiques, environnementales et sociales. Ses objectifs sont pourtant difficiles à tenir en pratique car peu de données sont aujourd’hui disponibles pour mesurer l’ensemble de ces expositions actuelles et passées. Comment les programmes de l’EHEN s’adaptent donc à cette disponibilité limitée des données ? En quoi ce manque d’informations pourrait influencer les résultats produits et les politiques qui en découleraient ? Intéressé par les nombreuses promesses de l’exposome, un groupe de chercheurs en sciences humaines et sociales (géographie, philosophie, histoire des sciences) a mené l’enquête et analysé les choix méthodologiques des neuf programmes de l’EHEN.
Leurs résultats soulignent la montée en puissance des études avec une augmentation significative des volumes de données traitées et des interactions scientifiques par rapport aux études antérieures. Pour autant, la disponibilité limitée des données d’exposition incite les chercheurs de l’EHEN à réaliser leurs études dans les zones géographiques où les outils de collecte de données sont les plus avancés et les plus étendus, c’est-à-dire principalement dans les zones urbaines voire métropolitaines. Exposition la plus « facilement » estimable à l’échelle locale et caractéristique des espaces urbains, la pollution de l’air occupe ainsi une place prépondérante dans les différentes études exposomiques. Cette sorte de « sélection spatiale » des terrains d’études s’observe également à l’échelle internationale puisque les pays d’Europe Centrale et de l’Est, probablement aussi pour des raisons de disponibilité limitée des données d’exposition, sont bien moins représentés dans ces projets par rapport aux pays d’Europe du Nord ou de l’Ouest.
Une ambition politique à nuancer
Alors que les études de l’EHEN étaient appelées à fournir « de nouvelles preuves pour de meilleures politiques préventives » en Europe, les conséquences de cette focalisation spatiale de l’approche exposomique ne seraient pas seulement scientifiques mais aussi géopolitiques. En effet, des actions ambitieuses et fondées sur les preuves apportées par l’EHEN porteraient essentiellement sur les facteurs de risque étudiés dans les espaces urbains (pollution de l’air, bruit, accessibilité des espaces verts) et permettraient d’améliorer significativement la santé dans ces espaces. Parallèlement, ces mêmes mesures seraient peu pertinentes pour répondre aux facteurs de risque spécifiques des zones rurales et des pays d'Europe de l'Est, comme la défavorisation sociale ou certains modes de vie. Ce qui pourrait involontairement renforcer les inégalités géographiques de santé…
Les limites spatiales actuelles du concept d’exposome soulignent l’intérêt et la pertinence d’investissements en France et en Europe dans des outils de mesure des différentes expositions à l’échelle locale. En effet, ces outils permettraient de mettre en œuvre partout les promesses de l’exposome, de soutenir d’importantes avancées scientifiques en la matière et de répondre également aux attentes citoyennes concernant la mesure des risques environnementaux.
Partenaires :
Pour en savoir plus : Fayet Y, Bonnin T, Canali S, Giroux E. Putting the exposome into practice: An analysis of the promises, methods and outcomes of the European human exposome network. Social Science & Medicine. 1 août 2024;354:117056.