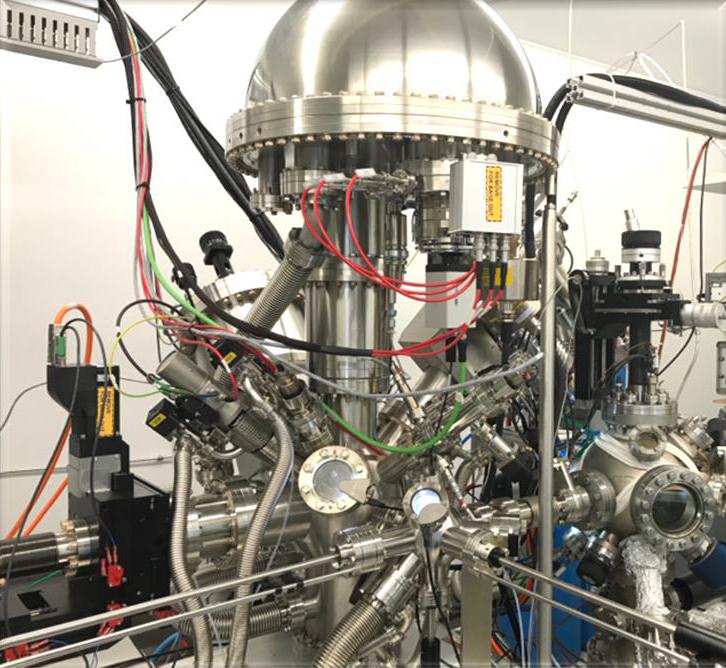Le 17 mai 2024
Technologie
« Briller tout en faisant de belles économies » : des ampoules LED à la fabrication optimisée

Olympe Delmas
Journaliste scientifique
Scientifique interrogé

Guy Tsamo
Docteur en ingénierie des matériaux et membre de l'Institut Pascal de l'Université Clermont Auvergne (UCA)